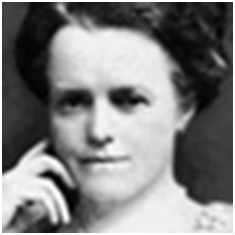
| Romancière et grande voyageuse, Sarah MacNaughton rejoint l’ambulance du docteur Munro en septembre 1914. En part ensuite en Russie, dans le Caucase, où elle assiste au génocide arménien, et en Perse, où elle meurt de la sprue. |
Infirmière sur la côte belge, au Caucase et en Perse
Romancière britannique née à Partick, près de Glasgow, en 1864, Sarah MacNaughtan est la fille d’un employé de c ompagnie maritime. Éduquée à domicile par son père, elle déménage en Angleterre quand elle devient orpheline. Après avoir vécu quelque temps dans le Kent, elle s’installe à Londres. Sarah MacNaughtan publie son premier roman, Selah Harrison, en 1898. Plusieurs autres suivront, dont The Fortune of Christina M’Nab (1901) et A Lame Dog’s Diary (1905), qui lui valent un certain succès. Grande voyageuse, elle se rend au Canada, en Amérique du Sud, en Afrique du Sud, au Moyen-Orient et en Inde. Elle participe au mouvement des suffragettes sans toutefois être militante. Après avoir signé les blessés pendant la guerre des Balkans, elle s’investit dans des missions sociales pour les pauvres de l’East End de Londres et travaille pour la Croix-Rouge pendant la seconde guerre des Boers.
Sarah MacNaughtan se trouve au Canada quand la Grande Guerre éclate et décide de revenir immédiatement en Grande-Bretagne. Elle embarque pour la Belgique le 20 septembre et travaille au sein de l’unité hospitalière de Mabel Annie St Clair Stobbart à Anvers. Quand la ville tombe aux mains des Allemands, elle rejoint l’ambulance du docteur Munro. Après avoir dispensé des soins pendant trois mois à l’hôpital de Furnes, elle crée une cantine dans la gare de cette même ville, puis dans celle d’Adinkerque. Sa petite cantine ferroviaire distribue de la soupe, du café, des sandwiches et des chaussettes aux soldats et aux blessés en transit.
Après avoir été décorée de l’Ordre de Léopold pour ses actions sur le front belge, elle retourne en Grande-Bretagne pour donner des conférences visant à encourager l’effort de guerre. Elle refuse d’être payée, ayant toujours mis un point d’honneur à subvenir à ses besoins. En octobre de cette même année, elle intègre la Croix-Rouge et part pour la Russie. En février, Sarah MacNaughtan se rend dans le Caucase, où elle est témoin du génocide arménien. Elle poursuit ensuite vers la Perse, dans l’espoir de pouvoir y poursuivre son oeuvre sanitaire. Malheureusement, elle contracte la sprue et doit revenir en Angleterre. Sa maladie, compliquée par une sévère anémie, s’avère fatale. Elle meurt de 4 juillet 1916.
Son journal (A woman’s diary of the war) est publié en 1915. Il relate les quelques mois qu’elle a passés en Flandre belge. Un autre journal, incluant son expérience en Russie et en Perse, sera publié par sa nièce en 1919 sous le titre de My war experiences in two continents. Ces deux témoignages nous donnent de précieux renseignements sur l’organisation des services de santé au début de la guerre et les conditions précaires dans lesquelles le personnel soignant devait travailler. L’auteure accompagne parfois son récit de réflexions sur ce qui différentie les hommes et les femmes en temps de guerre. Si certains propos sont convenus, d’autres apportent un éclairage original sur l’action et le ressenti de celles qui ont volontairement oeuvré au coeur même de la mêlée.
Le premier obus tombé sur Anvers est passé devant ma fenêtre ouverte et a explosé près du couvent. Nous nous sommes toutes habillées, et, comme des écolières, ai-je pensé, nous avons traversé la route pour rejoindre l'hôpital sous le clair de lune. Nous marchions lentement, une affaire d'honneur, je suppose. Il existe une obstination britannique, que nous avons pu observer de nombreuses fois pendant la guerre, qui n'admet pas la précipitation quand tombe une saleté d'obus allemand. Elle a coûté plus d'une vie, mais c'est une bonne chose, je trouve.
Le personnel de l'hôpital était déjà en pleine effervescence. Dès que les obus ont commencé à pleuvoir, les pauvres blessés se sont tous mis à crier. Plusieurs d'entre eux, que nous n'imaginions pas voir remarcher un jour, ont sauté de leur lit. Les infirmières les ont rassurés en leur promettant que nous ne les laisserions pas tomber, ce qui leur procura un étrange sentiment de sécurité - comme si une poignée de femmes pouvait les protéger des obus !
L'hôpital était une structure légère, principalement en verre, sous laquelle se trouvait une petite cave à charbon. Elle n'offrait aucune protection valable, et même si tel avait été le cas le bâtiment au-dessus pouvait très bien s'effondrer et nous empêcher de sortir, mais cela faisait partie des risques à prendre, et le fait de se retrouver dans une cave offrait un semblant de protection qui satisfaisait les patients.
La veille, nous avions fait le maximum pour enlever les grilles et les barres de fer qui pourraient obstruer l'entrée. Nous avions aussi apporté des matelas, des provisions et de l'eau en quantité. Des instructions avaient été données : tout le monde savait où trouver les équipements. Le personnel était uniquement constitué de femmes : deux filles sont sorties pour aller éteindre le gaz au compteur, afin d'éviter une explosion en cas de bombardement, et les autres se sont attelées à transporter les blessés sur des civières. J'ai vu une petite infirmière rousse emprunter trois fois la glissière à charbon qui donnait accès à la cave. A chaque fois, elle portait un homme sur le dos !
Pendant ce temps, les obus "tombaient comme de la grêle" selon l'expression d'un sergent anglais blessé.
Nous avions pour ordre de ne rien changer à nos habitudes. On nous a demandé qui était de service de nuit. Après avoir dit au-revoir à celles qui repartaient au couvent, nous avons allumé des petites lampes pour veiller les blessés. Ils étaient plus de cent dans cette cave, mais nous avions des matelas pour les cas les plus graves. Nous sommes remontées à l'hôpital pour récupérer des oreillers et des couvertures supplémentaires, et pour nous assurer aussi que tous les lits avaient été évacués.
La plupart des hommes dormaient, comme savent le faire les soldats en n'importe quelle circonstance ; mais nous avions aussi quelques cas désespérés de blessures gangrénées et d'affections graves, qui eux n'ont pas dormi de la nuit. Quelques hommes se tenaient debout parce que cette position les soulageait. D'autres encore dormaient sur les petits tas de charbon qui étaient restés dans la cave. Les petites flammes des chandelles jetaient d'étranges ombres sur les groupes de soldats en vareuse, tête ou bras bandé, et sur les visages blancs de ceux qui étaient allongés sur les matelas.
Je crois qu'ils ont apprécié notre présence. Ils semblaient penser qu'il était généreux de notre part de ne pas les laisser seuls. J'ai entendu un soldat dire à un autre, tandis qu'il s'enroulait dans sa couverture : "Mon Dieu ! Que les Anglaises sont comme il faut !" (1)
Ce genre de propos nous faisait chaud au coeur. Il était agréable d'entendre parler en bien de son pays. Je crois qu'à ce moment-là un lien d'amitié s'est établi entre la Belgique et nous et qu'il n'est pas prêt de se briser.
(1) En français dans le texte