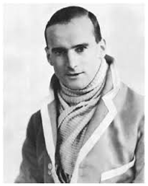
| Robert Sherrif ne n’imaginait pas que Journey’s End aurait un tel succès en 1929. Basée sur son expérience de sous-officier, la pièce décrit avec beaucoup de désenchantement l’état d’esprit qui régnait au front en 1918. |
Le succès théâtral de 1929
En 1929, personne ne s’attendait à ce que la pièce de Robert Sherriff, Journey’s End, devienne un des plus grands succès de la scène londonienne des années 20. Les œuvres théâtrales sur la Grande Guerre n’avaient jusqu’alors connu qu’une audience restreinte. Basée sur la propre expérience de l’auteur au front, la pièce se veut réaliste et sans exaltation héroïque, ce qui a séduit le public. Il est communément admis que Journey’s End a en partie déclenché le regain d’intérêt pour la littérature de la Grande Guerre à la fin des années 20. De nombreux mémoires ont en effet paru dans la foulée du succès théâtral de Sherriff.
Fils unique d’Herbert Sherriff, employé d’assurance, et de Constance Winder, Robert Cedric Sherriff naît en juin 1896 à Hampton Wick. En 1914, il quitte le lycée Kingston et trouve un emploi dans une compagnie d’assurance. En septembre, il postule pour suivre une formation d’officier mais l’armée juge son niveau d’études trop faible. En novembre 1915, il essaie à nouveau et réussit cette fois à intégrer le régiment de l’East Surrey. Suite à la perte de nombreux jeunes officiers et sous-officiers, l’armée avait décidé d’abaisser les critères d’admission.
Sherriff arrive en France en octobre 1916. Pendant les mois qui suivent, il prend part aux batailles de Vimy et de Messines. Après un cours de perfectionnement au tir, au Mont-des-Cats, Sherriff participe à la bataille de Passchendaele. Dans son autobiographie, No Leading Lady (1968), il décrit les conditions de vie insupportables dans lesquelles vivaient les hommes dans le secteur d’Ypres : La vie au campement était d’un sordide inimaginable. Tout était inondé et la nourriture immangeable. Dès les premiers jours de la bataille, Sherriff est atteint par les éclats de béton d’un blockhaus bombardé. Emporté à l’hôpital d’évacuation de l’Abeele, puis à l’hôpital général n°14 de Wimereux, il doit subir une opération au cours de laquelle on lui ôte du corps une cinquantaine de fragments.
Renvoyé en Angleterre, où il est soigné à l’hôpital Royal Victoria de Netlev jusqu’en novembre 1917, Sherriff rejoint ensuite un bataillon posté sur le sol anglais, avant d’être démobilisé en mars 1919. Ayant retrouvé un emploi dans les assurances, il écrit des pièces confidentielles pour le club d’aviron de Kingston.
Journey’s End est d’abord refusé par la plupart des théâtres londoniens avant que George Bernard Shaw ne s’y intéresse et persuade une compagnie de monter la pièce. Le succès sera au-delà de toutes les espérances. L’action est concentrée sur trois journées de mars 1918, juste avant la grande contre-offensive allemande. Le décor est réduit à une cagna de tranchée. Les personnages attendent, obéissent aux ordres et révèlent leur impuissance. Ils sont incapables de peser sur le cours des choses. Le personnage du capitaine Stanhope trouve la force de continuer sa mission d’officier dans le whisky. Le jeune Raleigh, qui vient d’arriver sur le front, le vénérait avant la guerre. Mais son héros a bien changé ! La guerre change les hommes, les déshumanisent. Elle tue aussi, sans gloire. Le réalisme de Journey’s End séduit les anciens combattants. Après dix ans de paix, il est enfin possible de jeter ce type de regard sur la guerre, dénué d’exaltation patriotique.
L‘année suivant, Sherriff adapte sa pièce pour en faire un roman et s’inscrit à Oxford pour suivre des études d’histoire. Au milieu des années 30, il s’installe à Hollywood et écrit de nombreux scénarios de film. Il ne retrouvera jamais le succès de Journey’s End., contrairement au comédien qui avait joué le personnage principal. Journey’s End est en effet un des premiers rôles interprétés par Laurence Olivier. L’autobiographie de Sherriff, No Leading Lady, publiée en 1968, revient dans le détail sur son expérience de guerre et sur le succès de la pièce qui l’a rendu célèbre.
Extrait de Journey’s End :
Colonel : Ça ne sert à rien de ruminer. Il n’y a après tout qu’une soixantaine de mètres à parcourir. Les boches vont tirer dans le brouillard. Osborne est un type qui a la tête sur les épaules et Raleigh sera parfait pour foncer dans la tranchée. J’espère que vous avez choisi des hommes valables pour les accompagner ?
Stanhope : Les meilleurs. Des tout jeunes. Des gars costauds et futés.
Colonel : Parfait (Après une pause) Vous savez parfaitement que j’aurais tout donné pour faire annuler ce coup de main. C’est une sale affaire, mais il faut obéir.
Stanhope : Je le sais, mon colonel.
Colonel : Les chiffons rouges accrochés aux barbelés ont-ils perturbé les hommes ?
Stanhope : Difficile à dire. Ils en plaisantent. Ils disent qu’on ne peut pas indiquer de meilleure façon le chemin vers la brèche.
Colonel : Voilà la bonne attitude, Stanhope.
[Osborne et Raleigh descendent les marches]
Alors, Osborne, tout est prêt ?
Osborne : Oui, mon colonel, je crois que tout est prêt. C’est pour dans un quart d’heure.
Colonel : Exact.
Osborne : Les hommes seront au parapet à moins trois.
Colonel : Les bombes à fumée seront lancées à l’heure prévue. Vous leur donnerez l’ordre de sortir de la tranchée quand la fumée sera suffisamment épaisse ?
Osborne : C’est ce qui est prévu.
Stanhope (en direction de la cagna de l’ordonnance) : Mason !
Mason : J’arrive !
Stanhope : Les hommes ont-ils eu leur ration de rhum, Osborne ?
Osborne : Oui. En un quart d’heure, il aura le temps de faire son effet.
Colonel : Parfait. Ils sont d’attaque ?
Osborne : Oh, oui. Ils le sont.
(Mason entre avec deux tasses de café et les pose sur la table)
Stanhope : Vous voulez aller leur parler, mon colonel ?
Colonel : Je ne sais pas. Vous ne croyez pas qu’ils préfèrent ne pas être dérangés ?
Stanhope : Je crois qu’ils apprécieraient quelques mots de votre part.
Colonel : Très bien. Si vous le dites.
Osborne : Ils sont regroupés dans la cagna du milieu, mon colonel.
(Le colonel s’attarde un instant. Un silence gêné. Le colonel se racle ensuite la gorge.)
Colonel : Eh bien, bonne chance, Osborne. Je suis sûr que vous ferez du beau travail.
Osborne (serrant la main que lui tend le colonel) Merci, mon colonel.
Colonel : Soyez vifs comme l’éclair. Attrapez le premier boche sur lequel vous tomberez et ramenez-le-nous. Un seul, ça ira, sauf si vous estimez qu’il est plus facile d’en prendre plusieurs.
Raleigh (serrant la main offerte par le colonel) : Entendu, mon colonel.
Colonel : Et si vous réussissez, je vous recommanderai tous deux pour la Médaille Militaire.
(Osborne et Raleigh murmurent un remerciement.) Souvenez-nous que beaucoup de choses peuvent dépendre de la capture d’un Allemand. Cela peut même nous faire gagner la guerre. On ne sait jamais (une autre pause). Je vous souhaite bonne chance à tous deux.