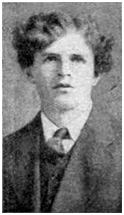
| Ouvrier autodidacte, Patrick MacGill publie juste avant la guerre Children of the Dead End, une référence en matière de littérature prolétarienne. Brancardier en 1915 en Artois, il écrit The Great Push, centré sur la bataille de Loos. |
Témoignage d’un brancardier irlandais
Le parcours de l’auteur irlandais Patrick MacGill ne suit pas, loin s’en faut, un schéma classique. Issu d’une famille de paysans pauvres du Donegal, il quitte l’école à dix ans pour se faire embaucher comme valet dans les grandes fermes des comtés de Tyrone, Fermanagh ou Derry. Le départ de ces enfants, souvent les aînés de la famille, permet aux parents de compter une bouche de moins à nourrir. Leur maigre salaire est un appoint nécessaire pour subvenir aux besoins du reste de la famille et payer le loyer. Les propriétaires terriens des grandes régions agricoles organisent deux fois par an une foire à Strabane pour l’embauche de cette main d’œuvre jeune et bon marché. Dans ses écrits, Patrick MacGill qualifiera plus tard la foire de Strabane de « marché aux esclaves ». Les enfants passent en général quelques années dans les fermes irlandaises avant de prendre la direction de l’Écosse, où ce genre de main d’œuvre est recherché pour les récoltes de pommes de terre et de navets, les ouvriers écossais préférant quant à eux travailler en usine pour une paie plus élevée. Patrick MacGill s’intègre aux équipes de ramasseurs de pommes de terre, avant de trouver un emploi régulier sur la ligne de chemin de fer Glasgow-Greenock.
Patrick MacGill aurait pu avoir le même destin que nombre de ses compatriotes et suivre la voie toute tracée d’une vie miséreuse, sans espoir d’évolution sociale. Mais c’est un garçon avide d’apprendre, qui malgré une éducation sommaire lit abondamment. Il admire Kipling, ainsi que les romanciers français et russes. Le réalisme de Zola, Hugo ou Tolstoï l’attire particulièrement. Son premier recueil de poésie reflète ses préoccupations sociales. Il y évoque les ouvriers exploités qui bâtissent la civilisation de demain mais restent à l’écart de la société. Patrick MacGill envoie également des articles au Daily Express. Le journal l’embauche aussitôt. Sa vie change du tout au tout. Si son activité de journaliste est de courte durée, elle lui permet toutefois de côtoyer le milieu intellectuel. C’est ainsi qu’il fait la connaissance du chanoine John Dalton, qui avait été aumônier auprès de la reine Victoria et s’occupe maintenant de l’administration du château de Windsor.
Le jeune Irlandais peut maintenant s’adonner à l’écriture dans un environnement radicalement différent des cabanes de terrassier où il a écrit ses premiers poèmes. Un recueil intitulé Songs of a Navvy paraît, suivi d’un autre, pour lequel il n’a aucune difficulté à trouver un éditeur londonien. Il se consacre ensuite à l’écriture d’un roman, Children of the Dead End, autobiographie d’un terrassier. Le livre crée la sensation littéraire en raison de la jeunesse de l’auteur et du milieu dont il est issu. C’est l’œuvre d’un autodidacte qui a réussi à se forger un style personnel sans autre formation que celle de la lecture. La chose est assez rare pour que l’on s’y arrête. Son style est alerte, précis et d’une grande richesse d’expression. On peut certes lui adresser quelques reproches formels, mais la vitalité de la langue finit toujours par emporter l’adhésion. Le livre décrit la vie de l’auteur en Irlande et en Écosse, et s’attaque au système qui oblige tant de ses compatriotes à vivre dans la misère. Les critiques envers les propriétaires terriens, mais aussi les prêtres et les commerçants, ne sont pas appréciés de tous en Irlande. Le public voit en Patrick MacGill un porte-parole de la classe ouvrière. Mais son récit suivant, The Rat Pit, n’a pas le même impact que Children of the Dead End, qui restera un livre important dans la littérature irlandaise ainsi qu’un document social unique en son genre.
Engagé volontaire dans le régiment des London Irish, MacGill s’attelle naturellement à témoigner de son expérience de combattant. The Great Push paraît en 1916. Dans l’introduction, il précise que la quasi totalité du livre a été écrite sur les lieux mêmes de l’action. Pourtant ce récit ne nous donne pas l’impression d’un compte rendu écrit dans la précipitation. En fait, il se démarque nettement des journaux de combattants publiés à l’époque. Le resserrement de l’action (La bataille de Loos), une narration par scènes qui évite la monotonie des « carnets de bord », l’art du dialogue, la qualité des descriptions et surtout la restitution puissante de certaines atmosphères, tout cela concourt à faire de The Great Push un livre d’une lecture agréable, qui témoigne avec force du vécu des combattants. De par le ton utilisé, qui allie humour et gravité, et la limpidité du récit, cet ouvrage trouve sa place parmi les oeuvres fortes de la littérature britannique des tranchées et nous donne sur la guerre un regard multiple, où les scènes de camaraderie côtoient les descriptions crues de la mort au combat. Blessé, Patrick MacGill sera évacué mais continuera d’écrire sur son expérience de brancardier. The Amateur Army et The Red Horizon seront toutefois moins réussis que The Great Push.
En 1915, il épouse Margaret Gibbons, auteure et journaliste. Après la guerre, il continue d’écrire et explore à nouveau les thèmes irlandais et écossais de Children of the Dead End. En 1930, Patrick MacGill s’installe au États-Unis avec sa femme et ses trois filles. Il tombe dans l’oubli et meurt en Floride en 1963.
Il n’est que très rarement fait mention de The Great Push dans les études sur la littérature britannique de la Grande Guerre. Ceci est non seulement injuste mais constitue aussi une erreur de jugement : The Great Push est une oeuvre originale qui ne connaît pas d’équivalent sous cette forme dans la littérature de témoignage issue des tranchées.
Extrait :
Bill alluma une bougie et la posa par terre tandis que je tendais une toile pour obscurcir la fenêtre. Nous étions à trois kilomètres du front, et une lumière non dissimulée pouvait être vue de l’ennemi. Je jetai un oeil dehors, des gars en uniforme flânaient dans la rue, le bout de leurs cigarettes rougeoyaient… Des fusées éclairantes s’élançaient dans le ciel au-dessus de Bully-Grenay, et j’eus à nouveau la sensation que l’ennemi était à portée de main.
Kore, un homme de notre section, revenait d’un estaminet proche ; ses mouvements nerveux indiquaient un trouble évident. Ses narines délicates et ses lèvres frémissaient. Nous pensions tous à ce qui nous attendait à l’aube. Il portait sous son bras une bouteille de champagne, qu’il posa par terre, près de la bougie. Il poussa un petit soupir et s’allongea à même le sol, ayant pris soin auparavant de balayer la poussière à l’aide d’un journal. Kore était un homme coquet, très fier de son uniforme, qui lui allait à merveille.
Felan et M’Crone arrivèrent ensemble, bras dessus bras dessous. Ce dernier était en proie à une excitation qu’il tentait en vain de réprimer; son corps tout entier tremblait comme sous l’effet de la fièvre ; quand il parlait sa voix très aiguë sonnait faux, preuve qu’il était en proie à une grande tension nerveuse. Felan semblait à l’aise, même s’il ne cessait de boutonner et déboutonner ses rabats, de fouiller dans les poches de sa tunique, comme s’il était à la recherche de quelque chose qui n’y était pas. Il n’avait pas de raison de paniquer ; en tant que cuistot de la compagnie, il ne devait pas participer à l’attaque.
– T’es verni, mon cochon, dit Bill en lançant un oeil à Felan. Je paierais cher pour être le cuistot demain.
– Je pourrais presque dire la même chose.
– Qu’est-ce que tu veux dire ?
– Tu crois qu’un Irlandais pourrait faire tranquillement la popote pendant que son régiment monte à l’assaut ? demanda Felan. Ce serait une honte !
Nous nous levâmes tous pour lui serrer solennellement la main et lui souhaiter bonne chance.
– Et les adresses ? demanda Kore. Il est temps de se les échanger.
– Oui, dis-je, ce sera une bonne chose de faite.
Mais personne ne voulait commencer. Nous répugnions à cet échange d’adresses. Il signifiait trop que nous acceptions l’inévitable. C’était la seule chose qui nous séparait de la mort. Si nous pouvions la reporter ne serait-ce qu’un peu…
– Buvons un coup pour nous donner du courage, dit Bill avant de faire sauter un bouchon.
La bouteille fut passée de main en main, et nous nous servîmes tous, sauf le caporal qui ne buvait jamais une goutte d’alcool.
– Commençons, dis-je.
L’alcool m’avait donné de l’énergie.
– « Si je suis tué, écrire à… pour leur dire que ma mort a été brutale et …sans souffrance. »
– C’est exactement ce qu’il faut leur dire, approuva le caporal. C’est toujours mieux de dire à la famille que la mort a été brutale et sans douleur. Ce n’est pas une grande consolation, mais…
Il ne continua pas sa phrase.