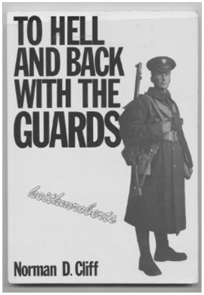
| Publiés en 1988 , onze après la mort de l’auteur, ces mémoires adoptent un point de vue pacifiste. Journaliste, Norman Cliff a été toute sa vie un pacifiste militant. Il a notamment été l’ami de Gandhi. |
La boue et la colère
En 1914, Norman Cliff quitte son récent poste de journaliste au Torquay Time pour s’enrôler dans les Grenadier Guards. Il prend part aux batailles de la Somme et de Passchendaele, et décroche la Médaille Militaire pour sa vaillance au combat. Après l’Armistice, il est engagé au News Chronicle, au poste de responsable éditorial pour les affaires étrangères. A la fin des années 30, il milite ouvertement pour le pacifisme. En 1946, il devient correspondant en Inde et se lie d’amitié avec Gandhi.
To Hell and back with the Guards paraît en 1988, onze ans après sa mort. Ces mémoires, préfacés par l’ancien Premier ministre Harold Wilson, ont clairement pour objectif de dénoncer la guerre. Le regard porté sur la réalité des combats est sans concession. Comme ce fut le cas pour un certain nombre d’auteurs, Norman Cliff adopte d’emblée un point de vue que l’on peut qualifier de pacifiste. Son témoignage a pour but premier de faire prendre conscience à ses lecteurs de la nécessité à oeuvrer pour l’amitié entre les peuples.
En 1915, Norman Cliff arrive au centre d’entraînement des Guards à Caterham, où des sergents-majors aboient leurs ordres du matin au soir. L’objectif est clairement d’humilier les jeunes recrues pour les transformer en combattants aguerris. Les mémoires de Stephen Graham attestent également de la brutalité qui régnait dans cette caserne, surnommée à juste titre La Petite Sparte. Comme les Grenadier Guards servent régulièrement de sentinelles à la famille royale, ils subissent une seconde période de formation, à Chelsea, qui a pour but de polir leurs manières.
Pour décrire les combats et la vie dans les tranchées, Cliff recourt à un langage rude, reflet fidèle de la façon qu’avaient les combattants de s’exprimer. L’écriture tardive de ces mémoires alliée au point de vue pacifiste pourrait nous faire craindre une déformation des faits et un parti pris qui nuirait à l’objectivité du récit. Il n’en est rien. La première phrase de l’ouvrage donne le ton : Comme nous étions naïfs ! Le point de vue est d’emblée rétrospectif. Dans sa préface, l’auteur précise : J’ai essayé de créer un récit simple dans une langue se voulant aussi proche que possible des faits évoqués. Étant journaliste – et optimiste – j’avais à l’époque pris des notes sur nos actions militaires ainsi que sur les conversations que je jugeais reproductibles à l’écrit.
Le passage qui suit évoque une réalité que l’on retrouve dans tous les mémoires : la boue. Elle a été un ennemi au même titre que les balles et les obus, et a parfois tué. L’été et l’automne exceptionnellement pluvieux de 1917 ont transformé le saillant d’Ypres en un immense bourbier qui ralentissait fortement tout mouvement de troupes. Le bilan de la bataille de Passchendaele s’élève à 250 000 pertes britanniques, dont au moins 40 000 portés disparus, le plus souvent noyés dans la boue. Ces chiffres justifient amplement la référence à l’enfer présente dans le titre des mémoires de Norman Cliff.
Extrait :
Pour atteindre la crête, il fallait traverser un immense et sinistre bourbier, à l’atmosphère malfaisante. Toute tentative d’empiétement semblait vouée à l’échec. Bien plus que les dispositifs de défense en surface, fils barbelés et autres, que nous connaissions bien, la boue dévorante constituait un piège mortel, qui s’étalait dans toutes les directions. Les pieds y pataugeaient et s’y engluaient, prisonniers de cet ennemi invisible qui semblait bien décidé à nous aspirer dans ses profondeurs. Régulièrement, l’un d’entre nous glissait, tombait, et, alourdi par le barda et le fusil, sombrait rapidement dans la fange visqueuse. On l’attrapait par les bras et, tout en essayant de ne pas se laisser embourber, on le tirait de là, si la chose était humainement possible. Quand les sauveteurs s’enfonçaient à leur tour, c’était sans espoir. Nos efforts démesurés ayant alors échoué, le marécage avalait les victimes et leurs cris. Découragés, nous attendions ensuite l’ordre d’avancer et de continuer la lutte contre cet ennemi impitoyable, qu’on nous demandait de combattre sans relâche au même titre que les ennemis visibles.
Un des officiers qui nous accompagnaient, le lieutenant Chamberlain, fut si épouvanté par le spectacle des hommes qui se noyaient dans la boue, et ce malgré nos tentatives désespérées pour les récupérer, qu’il se mit tout à coup à frapper sauvagement, avec une badine, les épaules d’un de ceux qui s’enlisait. Nous fûmes tous saisis d’horreur à la vue de cet officier, d’ordinaire si compréhensif, dont les nerfs avaient craqué au point de recourir à ce genre de brutalité. Nos protestations eurent raison de son acharnement. L’homme fut sauvé, mais d’autres n’eurent pas cette chance et se noyèrent en criant leur peur. Il n’y avait pas d’épreuve plus pénible à vivre que celle d’avoir l’ordre d’avancer alors qu’un camarade subissait pareil sort, mais il fallait atteindre l’objectif, et nous avancions, tête baissée, rageant contre ces forces démoniaques qui étaient plus que nous ne pouvions supporter. Je n’ai jamais été aussi proche de l’Enfer qu’à ces moments-là.
Seule la démence pouvait pousser des hommes dans ce genre de piège mortel. Aussi, nous ne rencontrâmes pas d’opposition avant d’atteindre un terrain plus élevé, et il nous fallut alors faire une halte à la lisière de la forêt tant nos forces étaient diminuées. Nous creusâmes des trous pour nous mettre à l’abri du feu des mitrailleuses et attendre la suite des opérations. Ce à quoi avait abouti ce cauchemar infernal est insensé en matière de chiffres. Le front britannique avait avancé de 6000 mètres, mais notre brigade seule avait perdu plus de 700 hommes. La pluie incessante qui mit fin à l’attaque vers le nord fut notre véritable ennemie. Il n’y avait pas d’autre solution que d’arrêter les opérations et de renoncer à chasser les Allemands de la côte flamande.
Le compte rendu officiel stipulait : Succès des opérations menées par le maréchal Douglas Haig devant la crête de Passchendaele début octobre, avec un nombre importants de prisonniers capturés. En dépit d’incessantes contre-attaques allemandes, les Britanniques ont avancé jusqu’à la hauteur de Houlthulst Forest. Ainsi donc, de toute évidence, l’homme qui avait « dirigé la manoeuvre » était satisfait.